En 2020, la maison d’édition Au vent des îles fêtait ses 30 ans d’existence. Basée à Tahiti en Polynésie française, elle ambitionne de faire rayonner les littératures d’Océanie à travers un vaste catalogue d’auteurs, polynésiens, calédoniens, maoris, samoans ou Aborigènes d’Australie… La maison offre une variété de collections, entre littérature, polars, guides d’Océanie et beaux-livres. Le mois de juin a été marqué par la parution de la traduction du livre de Stan Grant, Sourde Colère : Un Aborigène indigné. Son auteur, grand reporter australien, livre sa réflexion personnelle sur les questions raciales, identitaires et culturelles qui tiraillent les populations aborigènes.
Entretien avec le traducteur David Fauquemberg, mené par Léopoldine Godon et José Tahhan
Comment avez-vous découvert le livre, et comment en êtes-vous venu à le traduire ?
C’est Christian Robert qui l’a découvert. Il s’agit du fondateur de la maison d’édition tahitienne Au Vent des îles, spécialisée dans tous les auteurs du Pacifique, de l’Australie jusqu’aux Fidji, en passant par la Nouvelle-Zélande. Il m’a demandé de traduire ce livre parce qu’il savait que j’avais déjà traduit des auteurs australiens et connaissait mon intérêt pour l’Australie, où j’ai vécu. Outre le fait d’être traducteur, je suis aussi écrivain et mon premier roman, Nullarbor, se passe en Australie, dans une communauté aborigène.
Avez-vous échangé avec Stan Grant autour de la traduction ?
Non. C’est un grand journaliste, il travaille jour et nuit. Il est finalement assez rare, pour un traducteur, d’avoir besoin d’échanger avec les auteurs qu’il traduit. Dans Sourde colère, les choses sont dites crûment, brutalement, le plus simplement possible dans la forme, si bien que le texte ne présente pas de difficultés d’ordre littéraire. L’auteur s’exprime dans ce texte comme s’il parlait à l’Australie pour lui adresser ses quatre vérités. La langue est limpide, directe et percutante, je n’ai donc pas eu besoin de lui poser des questions d’ordre linguistique.
Vous avez été vous-même reporter pour plusieurs revues : avez-vous ressenti une affinité particulière avec Sourde colère ?
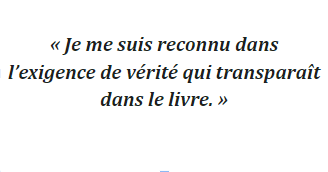 On ne peut pas comparer. On m’a commandé des récits littéraires pour la revue XXI ou le magazine Géo parce que je suis écrivain. Je ne suis pas journaliste de métier. Cependant, je me suis reconnu dans l’exigence de vérité qui transparaît dans le livre. Le récit de Stan Grant s’appuie sur des faits sociaux, culturels, historiques. On sent qu’il a l’habitude de citer ses sources avec précision, et qu’il a un intérêt marqué, humain, pour les petites gens. Il raconte dans le livre que, lors de ses reportages de guerre en Afghanistan, il aimait aller à la rencontre des paysans afghans dans leurs villages. Il explique que l’émotion née de ces rencontres était liée à l’impression de retrouver sa famille aborigène, car il voyait des gens pris en étau par la guerre, de la même manière que les siens étaient broyés par la société australienne. Il retrouvait ce sentiment d’exclusion qu’il avait toujours connu. Né d’un père du peuple Wiradjuri et d’une mère Kamilaroi, autre tribu aborigène du Sud-est de l’Australie, il a vécu cette marginalisation dans sa chair. C’est pourquoi cette proximité avec les sujets de ses reportages est très touchante.
On ne peut pas comparer. On m’a commandé des récits littéraires pour la revue XXI ou le magazine Géo parce que je suis écrivain. Je ne suis pas journaliste de métier. Cependant, je me suis reconnu dans l’exigence de vérité qui transparaît dans le livre. Le récit de Stan Grant s’appuie sur des faits sociaux, culturels, historiques. On sent qu’il a l’habitude de citer ses sources avec précision, et qu’il a un intérêt marqué, humain, pour les petites gens. Il raconte dans le livre que, lors de ses reportages de guerre en Afghanistan, il aimait aller à la rencontre des paysans afghans dans leurs villages. Il explique que l’émotion née de ces rencontres était liée à l’impression de retrouver sa famille aborigène, car il voyait des gens pris en étau par la guerre, de la même manière que les siens étaient broyés par la société australienne. Il retrouvait ce sentiment d’exclusion qu’il avait toujours connu. Né d’un père du peuple Wiradjuri et d’une mère Kamilaroi, autre tribu aborigène du Sud-est de l’Australie, il a vécu cette marginalisation dans sa chair. C’est pourquoi cette proximité avec les sujets de ses reportages est très touchante.
Peut-on dire que Stan Grant est en partie devenu journaliste pour rechercher le contact humain ?
Il ne s’attarde pas sur ce point dans Sourde colère. Mais être reporter de terrain, comme lui, c’est donner une voix aux réfugiés, aux exclus… En France, c’est Albert Londres qui incarne depuis plus d’un siècle cette figure du journaliste engagé, il a d’ailleurs donné son nom au prix qui récompense chaque année les meilleurs grands reporters. Albert Londres, c’est l’archétype du journaliste « à la Tintin », celui qui va au contact des populations et n’écoute pas seulement les représentants des gouvernements et les chefs d’armée. Il a fallu que Stan Grant se rende au fin fond de l’Himalaya pour se reconnaître en la personne d’un berger afghan.
Pensez-vous que votre attachement aux cultures océaniennes a donné à la traduction une dimension particulière ?
Ce livre m’a particulièrement touché car j’ai commencé à écrire à la suite d’un long voyage en Australie, et d’une rencontre bouleversante avec les aborigènes de la tribu Bardi. J’ai par la suite voyagé un peu partout en Océanie. Mon dernier roman, Bluff, se déroule entre la Nouvelle-Zélande, les atolls de Micronésie et la Polynésie française, autour d’une histoire de navigateurs aux étoiles et de pêche à la langouste. Dans Sourde colère, j’ai été touché par la scène où Stan Grant emmène son fils au bord d’un trou d’eau sacré, théâtre du massacre de ses ancêtres Wiradjuri. Son fils ne connaît pas cet aspect de sa culture et s’assoit simplement pour écouter le son de l’eau.
Les aborigènes d’Australie ont un rapport incroyable à la nature. C’est une des seules cultures au monde à posséder plus de 50 000 ans d’histoire en un même endroit, c’est dire la connaissance intime qu’ils en ont. Avant d’écrire Nullarbor, j’ai passé plusieurs semaines dans une communauté aborigène du Kimberley, au Nord-ouest de l’Australie. Les Bardi, qui vivent là depuis une éternité, sont des pêcheurs quasi-surnaturels et connaissent quasiment chaque arbre par son nom ! Ils ne craignent pas les serpents, ni les redoutables crocodiles de mer, car ils savent tout de leur comportement. Les Maoris et les Tahitiens ont également gardé ce lien très fort avec la nature. Elle est comme un membre de leur famille car les esprits de leurs ancêtres y sont liés. Cela m’a toujours fasciné.
En quoi la mythologie aborigène est-elle révélatrice du caractère sacré de la nature ?
De notre point de vue, disons, d’Occidentaux, les mythologies évoquent nécessairement un passé lointain, celui de la création du monde. Mais dans la plupart des récits mythologiques du Pacifique, le temps de la création n’est pas antérieur, ni même extérieur, au présent. Dans les mythologies aborigènes, le Serpent Arc-en-ciel n’a pas créé jadis telle montagne ou tel trou d’eau, : cette création continue de se faire à chaque instant. Aux îles Samoa, les gens enterrent encore souvent leurs proches juste devant la porte des maisons. J’ai vu des enfants saluer leur grand-mère, leur oncle défunts le matin, en partant à l’école ! On puise dans la sagesse des ancêtres pour régler les conflits et les problèmes de la vie de tous les jours. Stan Grant s’efforce de raccorder sa famille à cette culture ancestrale et d’y initier son fils.
Pourquoi est-il si difficile de soigner la blessure de l’histoire coloniale de l’Australie ?
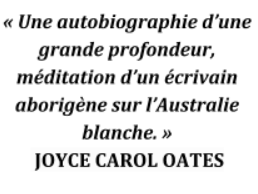
L’histoire du pays est particulièrement sanglante. À l’époque de la colonisation, la prise de possession des terres a été légitimée par le concept de terra nullius (l’idée que ces terres étaient inhabitées). En voyant les Aborigènes pour la première fois, les colons les ont qualifiés d’animaux et ont considéré que cette île était donc déserte. Les peuples autochtones ont été massacrés. Leur passé est jalonné d’événements douloureux. Jusqu’aux années 1930-40, les enfants métis, souvent nés de viols dans les plantations, étaient enlevés à leurs proches et confiés à des familles blanches, à l’autre bout du pays. Ces enfants de la Stolen Generation n’ont jamais connu ni leur culture ni leurs parents.
Dans un bar de la ville d’Alice Springs, située en plein désert au centre de l’Australie, j’ai moi-même vu une photo des années 1950 représentant un Aborigène enchaîné. Cette histoire est choquante, même si nous avons aussi en France une longue et douloureuse histoire coloniale. La différence, c’est qu’en Australie, les colons sont restés sur le même territoire que les colonisés…
Comment se fait-il que la plupart des Australiens connaissent si mal les cultures aborigènes ?
On peut vivre en Australie sans jamais croiser un Aborigène, ni entendre parler de leur culture. Il est extrêmement compliqué de remédier à cette situation. C’est très difficile pour un Australien blanc de se rendre dans une communauté aborigène, car il y a beaucoup de ressentiment et de culpabilité de part et d’autre. Pendant longtemps, l’histoire des Aborigènes n’était même pas abordée à l’école. Le gouvernement australien a présenté pour la première fois des excuses au peuple aborigène il y a une vingtaine d’années, mais les inégalités persistent.
Dans son livre, Stan Grant évoque l’auteur James Baldwin et la lutte des Black Panthers, parce qu’il y a beaucoup de points communs entre l’histoire des Afro-Américains et celle des Aborigènes. Les statistiques liées aux taux de chômage, d’incarcération, de maladie et de délinquance demeurent terribles au sein de ces populations. Stan Grant explique que le rêve australien est inaccessible pour les peuples aborigènes. Comme aux Etats-Unis, où les descendants des hommes et des femmes qui ont construit la richesse du pays, ces esclaves qui travaillaient dans les plantations du Sud, sont exclus du rêve américain.
En quoi le fait d’être écrivain vous aide dans le processus de traduction ?
Les éditeurs apprécient les traducteurs qui viennent, comme c’est mon cas, de l’écriture, car leur approche des textes littéraires est un peu différente. Le problème de la traduction ne réside pas essentiellement dans la compréhension de la langue source, mais dans la recherche d’un certain naturel en français, d’un ton, d’un rythme qui rende au mieux ceux de l’original. Le fait d’écrire peut donc aider, même s’il s’agit de deux exercices très différents. J’ai l’impression, d’ailleurs, qu’ils font appel à des parties différentes du cerveau ! La principale difficulté quand on est écrivain, c’est qu’à partir d’une page blanche, on doit créer des personnages de chair et d’os, imaginer un monde.
Pour ma part, j’alterne entre traduction et écriture, sur des périodes bien séparées. Les premiers jours de traduction sont souvent un soulagement, parce que le livre qui m’attend le matin est déjà écrit, il me reste « juste » à trouver une manière de rendre son atmosphère, son style, dans ma langue. Le fait d’être écrivain peut tout de même aider quand il s’agit de traduire des textes très littéraires. Par exemple, il me semble difficile de traduire de la poésie sans être soi-même un poète. Quand je traduis un roman de l’anglais ou de l’espagnol, je n’ai vraiment pas la sensation de réaliser un acte de création : je suis au service de l’auteur.
Comment décririez-vous la différence entre le plaisir d’écrire et le plaisir de traduire ?
Quand je suis plongé dedans, c’est la traduction qui est la moins ingrate. Le travail de traduction est balisé, on sait qu’en traduisant tant de pages par jour on pourra terminer tel chapitre ou telle partie en tant de temps. Je me suis lancé dans la traduction littéraire il y a 20 ans, un peu par hasard, parce que c’était un bon moyen de gagner ma vie et de me permettre d’écrire mes livres et de voyager. Au fil des années j’y ai pris goût. C’est un métier d’autant plus agréable quand il s’agit d’un très bon livre et qu’on a envie de défendre son auteur.
L’écriture d’un roman, en revanche, représente des mois, des années de travail. Les journées peuvent paraître longues, surtout lorsque vous n’avez écrit au bout du compte que trois lignes ou un quart de page ! Cela peut générer beaucoup de frustration. D’autant qu’on n’est, bien sûr, jamais satisfait du résultat final. En revanche, une fois un livre achevé, la satisfaction ressentie est sans commune mesure avec celle d’une traduction. L’acte d’écriture est plus intime. On pourrait comparer la traduction au fait de s’occuper des enfants d’un autre : l’écriture, c’est faire naître et élever le sien.
Comment vous êtes-vous décidé sur la traduction du titre ?

Généralement, je privilégie plutôt une traduction la plus littérale possible du titre. En l’occurrence, pour Talking to My Country, ça ne convenait pas. C’est l’éditeur qui a choisi Sourde colère : Un Aborigène indigné après une séance de brainstorming. « Parler à mon pays » ne faisait pas assez référence à l’Australie, et l’éditeur voulait qu’on puisse immédiatement situer le livre. Sourde colère avec le sous-titre Un Aborigène indigné permet de saisir très vite le thème et le ton du livre.
Comment la traduction aide-t-elle à transmettre dans d’autres langues l’identité des peuples aborigènes et comment contribue-t-elle à leur reconnaissance ?
Je pense que la traduction, notamment littéraire, a une fonction très noble. Le dialogue entre les peuples est une condition essentielle pour que les humains cohabitent de manière pacifique et, si possible, enrichissante. Or, si les livres ne sont pas traduits, leur lecture est réservée aux rares personnes qui maîtrisent totalement une ou plusieurs langues étrangères. Imaginez vivre au XXIème siècle sans avoir accès à Shakespeare, Dostoïevski et Goethe : notre expérience du monde serait beaucoup plus pauvre ! La traduction crée des ponts entre les cultures, mais aussi les époques.
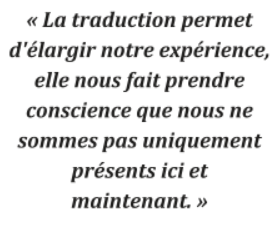
La traduction de Sourde colère permet ainsi de sensibiliser les lecteurs français à une réalité méconnue. De nombreux clichés entourent encore les Aborigènes, j’en avais moi-même été témoin lorsque mon roman Nullarbor était sorti en 2007. En Europe, on les imagine vivant dans le désert, jouant du didgeridoo et lançant des boomerangs pour tuer des kangourous. Or, il y a évidemment des Aborigènes avocats à Sydney, pêcheurs sur l’océan Indien, d’autres qui vivent dans les forêts tropicales du Nord australien…. Lors de mon séjour au sein de la tribu Bardi, j’avais demandé à un ancien pourquoi ils n’avaient pas de boomerangs, il m’a juste répondu : « Est-ce que tu as déjà essayé de lancer un boomerang dans une forêt ? »
Cette traduction de Sourde colère permettra aux lecteurs français d’avoir accès à l’expérience de Stan Grant à travers le récit poignant de sa vie, de s’interroger avec lui sur les mécanismes qui font que le racisme, malheureusement, continue de prospérer dans nos sociétés. Je suis convaincu que les lecteurs français peu coutumiers de l’Australie apprendront énormément en lisant ce livre.

